La semaine dernière, la thématique de mes cours était la mort.
La mort comme une fin, mais aussi comme une étape. Celle qui clôture un temps, une action, une pensée, une émotion, une relation… avant qu’autre chose ne débute.
Très vite, la réflexion a quitté le tapis pour devenir intime : qu’est-ce que je laisse mourir dans mon quotidien ? Où est-ce que je ne mets plus mon énergie, mon temps, ma passion, mon intérêt ?
Et derrière cette question, une autre est apparue : celle de l’intention. Est-ce un choix assumé ou non ? Un acte de courage ou une forme d’évitement ? Suis-je allée au bout ou ai-je baissé les bras ? Était-ce par manque d’intérêt, par découragement, par changement d’avis… par fatigue peut-être ?
Quand je regarde ma vie, il y a eu un peu de tout cela. Des élans sincères et des abandons nécessaires. Des lâchers-prise conscients et d’autres plus ambigus. Mais ce qui m’interpelle surtout, c’est tout ce qui meurt chaque jour, à chaque instant. Et dans ces « petites » morts, tout ce qui naît ensuite.
C’est là que la notion d’aparigraha, en yoga — le non-attachement — prend tout son sens. Elle ne nous demande pas de nous détacher de tout, mais d’observer avec lucidité ce à quoi nous nous agrippons encore, et ce qui, silencieusement, est déjà en train de se transformer.*
Les petites morts du quotidien
J’ai pris comme point de départ nos habitudes. Toutes celles que nous avons déjà laissées derrière nous — sans même parfois nous en rendre compte — et celles auxquelles nous nous accrochons encore, parce qu’elles rassurent, parce qu’elles structurent, parce qu’elles nous donnent une illusion de continuité. Aparigraha ne nous invite pas à tout lâcher violemment, mais à observer honnêtement ce à quoi nous nous identifions encore.
Puis il y a les relations. Celles qui durent depuis longtemps. Les amis de longue date, porteurs de souvenirs qui réchauffent le cœur, mais qui aujourd’hui ne sont peut-être plus que des présences lointaines, des connaissances, des traces affectives. Les maintenir telles qu’elles étaient peut parfois demander plus d’énergie que d’accepter qu’elles se transforment, se déplacent, ou se déclassent doucement.
Ces petites morts — ou ces micro-transformations — impliquent du changement. Et le changement n’est pas confortable. Il y a une perte de repères, un vertige face à l’inconnu : on sait ce que l’on a, on ne sait pas ce que l’on aura. En psychologie contemporaine, cela fait écho à notre besoin de sécurité et de prévisibilité, profondément ancré dans notre système nerveux.
Le vide n’existe pas
Pourtant, la nature ne laisse pas de vide. C’est un principe que l’on retrouve autant dans les philosophies orientales que dans les sciences du vivant. Ce qui disparaît nourrit autre chose. La terre transforme ce qui meurt en humus, cette matière sombre et fertile qui rend possible de nouvelles formes de vie ailleurs.
Dans la philosophie hindouiste, la transformation est inscrite au cœur même de l’existence : Shiva, principe de destruction, n’est jamais séparé de la création. Détruire, ici, ne signifie pas anéantir, mais rendre possible un renouveau. Mourir un peu pour continuer à vivre.
Avancer sur son chemin suppose alors d’accepter ces morts symboliques. Peut-être est-ce aussi à cela que nous invite Savasana. Ce moment où l’on abandonne toute action, toute posture, toute volonté. Une mort temporaire de l’ego agissant, pour laisser émerger autre chose. Renaître, peut-être, un peu différemment.
Fluidité, eau et tissus vivants
Le chemin de la transformation n’est jamais linéaire. Nous avons beau vouloir avancer, il y aura des détours, des retours en arrière, des spirales. Le taoïsme nous offre ici une image précieuse : celle de l’eau. L’eau ne force pas, elle contourne. Elle épouse les formes, suit le courant, s’adapte sans perdre sa nature.
Cette sagesse de l’eau résonne profondément avec notre corporalité. Notre corps est majoritairement composé d’eau, et cette fluidité se manifeste notamment à travers le système fascial. En ostéopathie et dans les recherches scientifiques récentes, les fascias sont reconnus comme un tissu vivant, continu, sensible, impliqué autant dans le mouvement que dans la perception et la régulation émotionnelle.
Dans l’approche somatique, on explore cette intelligence du corps qui se transforme de l’intérieur. Les fascias, en lien étroit avec le système nerveux, gardent la mémoire de nos expériences, de nos traumatismes, de nos histoires relationnelles. Ils peuvent se densifier, se nouer, perdre de la fluidité — comme des cailloux dans le courant.
Rester noué ou se laisser éroder
Face à ces obstacles, nous avons souvent le choix : rester cramponné aux rochers, maintenir la tension, ou accepter que certaines choses ne puissent pas être réparées. Non pas parce que nous avons échoué, mais parce qu’elles sont devenues obsolètes.
Ce qui a besoin de mourir n’a pas toujours besoin d’être arraché. Parfois, cela peut simplement se désagréger. Être lentement érodé par l’eau, par la conscience, par la présence. La transformation n’a pas à être brusque ou spectaculaire. Quand quelque chose est prêt à partir, cela peut devenir étonnamment simple, presque naturel.
Peut-être que pratiquer, réfléchir, ressentir, c’est apprendre à faire confiance à ce processus. À laisser l’eau faire son œuvre. À accepter de mourir un peu, encore et encore, pour continuer à vivre avec plus de justesse, de fluidité et de curiosité.
Mais au fond, la question qui demeure est celle de l’intention. Ce que je laisse mourir aujourd’hui, est-ce un abandon inconscient ou un choix aligné ? Est-ce que je me retire par peur, par fatigue, par évitement… ou parce qu’une part de moi sent que le cycle est arrivé à son terme ?
Dans la tradition yogique, on parle de svadhyaya, l’étude de soi : cette capacité à s’observer sans jugement, avec honnêteté. Peut-être que l’essentiel n’est pas tant ce qui meurt, mais la conscience avec laquelle nous accompagnons cette mort. Car lorsqu’un geste est posé avec clarté, même s’il implique une fin, il devient profondément vivant.
Alors peut-être que l’intention pourrait être celle-ci : ne pas laisser mourir par défaut, mais choisir consciemment ce que l’on nourrit et ce que l’on laisse se transformer. Accepter que certaines choses se désagrègent naturellement, et avoir le courage d’en clôturer d’autres. Mourir un peu, oui — mais en conscience. Pour que ce qui naît ensuite ne soit pas le fruit du hasard, mais l’expression d’un mouvement intérieur assumé.
Et si, cette semaine, vous vous demandiez : qu’est-ce que je choisis de laisser mourir — et qu’est-ce que je décide, pleinement, de faire vivre ? Où souhaitez-vous remettre de l’élan, de la présence, de la vérité ?
Peut-être que la transformation ne commence pas par un grand bouleversement, mais par une décision intime. Une orientation. Un pas presque invisible… mais résolument vivant.




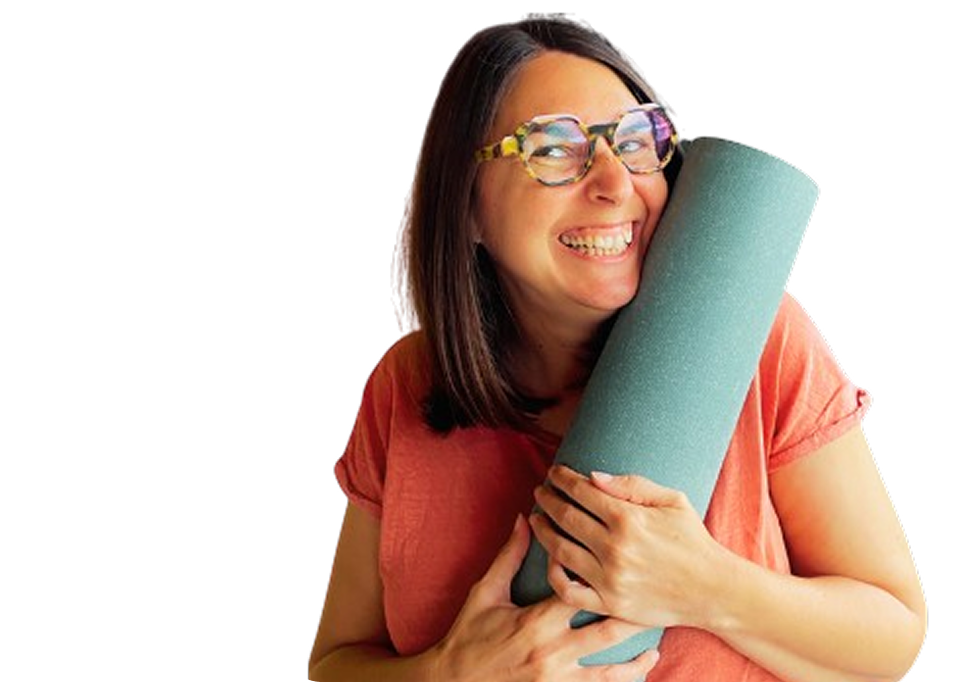
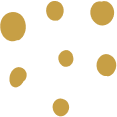

Laisser un commentaire