Quand le yoga s’accorde aux saisons du corps et de l’âme
« Celui dont la nourriture, le sommeil, l’effort et le repos sont mesurés, celui-là, par la pratique du yoga, détruit la souffrance. »
— Bhagavad-Gītā VI.17
Le yoga n’est pas un chemin tracé d’avance, mais une respiration qui s’accorde aux métamorphoses de notre existence. Rien n’est figé : nos corps se transforment, nos désirs évoluent, nos rythmes changent — et la pratique, si elle est vivante, nous accompagne avec la souplesse d’une alliée.
Cette idée n’est pas nouvelle. Déjà dans les textes fondateurs, les maîtres du yoga insistaient sur la mesure, l’écoute et l’ajustement. Plus récemment, T.K.V. Desikachar nous rappelle que
« ce n’est pas la personne qui doit s’adapter au yoga, mais le yoga qui doit s’adapter à la personne ».
T.K.V. Desikachar
Pratiquer, ce n’est pas plier notre corps aux exigences d’une forme figée. C’est entrer dans un dialogue intime avec nous-mêmes, où le souffle, les postures et la méditation deviennent des réponses aux besoins de chaque âge et de chaque saison de vie.
L’équilibre comme fondement
Dans la Bhagavad-Gītā, Krishna enseigne à Arjuna que la libération ne réside ni dans l’austérité excessive, ni dans la complaisance, mais dans l’harmonie : manger avec mesure, se reposer avec justesse, moduler l’effort.
Cette sagesse traverse les siècles. Les Yoga Sūtra de Patañjali rappellent que chaque posture doit être à la fois « stable et confortable » (sthira sukham āsanam). Plus tard, la Hatha Yoga Pradīpikā insistera sur la maîtrise du souffle comme clé de l’équilibre énergétique.
Ce fil rouge traverse l’histoire du yoga : rechercher l’équilibre, non la performance. Une perspective qui contraste avec notre époque, où l’on glorifie l’intensité et la productivité. Et si la pratique devenait au contraire l’espace où l’on s’autorise à ralentir, à s’écouter, à se rencontrer vraiment ?
L’équilibre, une sagesse ancestrale
Bhagavad-Gītā VI.17 : « la mesure dans l’effort, le repos, l’alimentation et le souffle ». : la libération ne se conquiert pas dans l’excès mais dans la mesure. La discipline devient vivante lorsque le corps, le souffle et l’esprit coopèrent. C’est une sagesse que l’on retrouve dans le Yoga Sūtra II.46 : la posture juste (sthira sukham āsanam) doit être à la fois ferme et confortable et dans la Hatha Yoga Pradīpikā II.2-3 : la régulation du souffle comme clé de l’équilibre énergétique.
Ces textes nous rappellent que le yoga n’est pas une conquête mais une alliance subtile entre action et réceptivité.
« Le yoga est un art de l’attention. Ce n’est pas ce que nous faisons qui importe, mais la manière dont nous habitons ce que nous faisons. »
— Donna Farhi
Le yoga dans les différentes étapes de nos vies
À l’aube de la vie : accueillir l’élan de l’adolescence et de la jeunesse
L’adolescence est un printemps intérieur, à la fois vibrant et chaotique. Le corps se transforme, l’énergie afflue, et l’identité cherche encore ses repères. Dans cette effervescence, le yoga peut devenir un refuge : un espace pour respirer, écouter, ralentir.
Les séquences dynamiques — salutations au soleil, postures d’équilibre, enchaînements fluides — accompagnent l’élan vital propre à cet âge. Elles offrent un exutoire à l’énergie débordante, tout en posant les premières pierres de l’attention consciente. Pourtant, Patañjali nous rappelle que la posture juste doit être « sthira sukham āsanam » — stable et confortable (Yoga Sūtra II.46). La puissance n’est rien sans enracinement : l’effort se construit sur la stabilité, la souplesse s’enracine dans l’écoute.
Introduire tôt la conscience du souffle, c’est offrir aux jeunes pratiquants un outil d’autorégulation qui les accompagnera toute leur vie. Même une respiration simple, comme Nadi Shodhana — la respiration alternée — favorise l’équilibre du système nerveux et apaise les émotions fluctuantes. Dans un monde où les sollicitations se multiplient, le yoga leur enseigne à revenir au centre.
L’adolescence est une période où les cartilages, les tendons et la structure osseuse sont encore en pleine évolution. Les postures extrêmes ou répétées peuvent fragiliser les articulations. Les pratiques équilibrées privilégient l’ancrage, la mobilité fonctionnelle et la respiration consciente, préparant un corps fort mais aussi sensible à ses signaux.
Pratique guidée : Adolescence et jeunesse
Durée : 30 à 40 minutes
Intériorisation : courte méditation guidée sur la présence corporelle.
Éveil corporel : quelques cycles de Surya Namaskar (salutation au soleil), pour stimuler l’énergie et l’ancrage.
Force et équilibre : Vrikshasana (posture de l’arbre), Virabhadrasana II (guerrier II), pour cultiver la stabilité intérieure.
Respiration consciente : initiation à Nadi Shodhana (respiration alternée), afin d’harmoniser les deux hémisphères cérébraux.
La grossesse et le post-partum : un dialogue d’écoute
La grossesse est une métamorphose. Chaque jour, le corps invente de nouvelles formes, de nouvelles sensations. Les équilibres se déplacent, les émotions s’amplifient, et la relation à soi s’approfondit. Dans ce moment d’intense transformation, le yoga devient un compagnon silencieux : il ne cherche pas à contraindre, il accompagne.
Les postures assises et soutenues — Baddha Konasana, Supta Virasana — offrent un espace pour libérer le bassin et relâcher les tensions lombaires. Les respirations profondes, comme la respiration complète (Dirga Pranayama), calment le mental tout en améliorant l’oxygénation. Ici, la pratique s’aligne sur le rythme du corps, et non l’inverse.
Comme le rappelle Donna Farhi,
« remettre l’autorité au corps, c’est l’honorer dans sa sagesse propre ».
Le yoga prénatal nous invite à écouter plutôt qu’à performer, à accueillir plutôt qu’à contrôler.
Après l’accouchement, la pratique soutient le processus de réorganisation intérieure : retrouver un lien intime avec le souffle, renforcer doucement le plancher pelvien, apaiser les tensions émotionnelles. Dans cette période sensible, le yoga est moins un exercice qu’une invitation à se retrouver.
Dans de nombreux studios, des cours spécifiques permettent aux femmes enceintes de rester actives tout en respectant leur physiologie. Le renforcement du plancher pelvien, la mobilité douce du bassin et les techniques respiratoires favorisent une meilleure récupération post-partum. C’est l’application directe du principe fondateur : le yoga se met au service de la vie.
Pratique guidée : Grossesse et post-partum
Durée : 25 à 35 minutes
Postures d’ouverture douce : Baddha Konasana (posture du papillon) et Supta Baddha Konasana (variation allongée) pour libérer le bassin.
Respiration consciente : Dirga Pranayama (respiration yogique complète), pour apaiser le mental et oxygéner les tissus.
Relaxation finale : visualisation guidée pour favoriser la récupération et le lien mère-enfant.
Renforcement postnatal* : exercices doux pour le plancher pelvien et les abdominaux profonds.
*après rééducation périnéale.
Ménopause et vieillissement : la sagesse du souffle
vec l’avancée en âge, les rythmes se modifient. Les tissus se réorganisent, les cycles s’espacent, et le corps appelle à une nouvelle forme d’attention. La ménopause marque un passage : un bouleversement hormonal qui peut parfois s’accompagner d’insomnie, de bouffées de chaleur, d’anxiété ou de baisse d’énergie. Pourtant, cette étape porte aussi une promesse : celle d’une liberté renouvelée, d’une reconquête de soi.
Le yoga devient alors un refuge pour réguler, restaurer, équilibrer. Les postures restauratives, comme Supta Baddha Konasana ou Viparita Karani, soutiennent le corps et apaisent le système nerveux. Les techniques de respiration lente et profonde, telles que Bhramari Pranayama (le bourdonnement de l’abeille), permettent de calmer le mental et de réduire l’agitation intérieure.
Judith Hanson Lasater le rappelle :
« Le repos conscient n’est pas un luxe, c’est une nécessité pour préserver la vitalité ».
Dans cette période de transition, le yoga invite à lâcher la quête de performance pour renouer avec le souffle essentiel, celui qui relie le corps, l’énergie et l’esprit.
Pratique guidée : Ménopause et vieillissement
Durée : 40 à 50 minutes
Postures restauratives : Supta Baddha Konasana (allongé soutenu), Viparita Karani (jambes contre le mur).
Respiration apaisante : Bhramari Pranayama (respiration de l’abeille) pour calmer le mental.
Méditation silencieuse : observation du souffle naturel, pour cultiver la paix intérieure
Les hommes et les troubles liés à la masculinité : accueillir la vulnérabilité
Longtemps, le yoga a été associé à une pratique féminine en Occident, mais son essence transcende les genres. Aujourd’hui, de plus en plus d’hommes s’y tournent, cherchant un espace pour réconcilier force et vulnérabilité.
Les défis masculins contemporains sont multiples : stress chronique, pression de performance, baisse progressive de la testostérone, troubles liés à la fertilité, fatigue émotionnelle… Autant de réalités que le yoga peut accompagner, non pas en imposant une discipline, mais en ouvrant un espace d’écoute.
Les pratiques axées sur la respiration consciente — comme Nadi Shodhana ou Ujjayi Pranayama — aident à réguler le système nerveux et à mieux gérer les états de tension. Les postures d’ouverture du bassin et du cœur — Anjaneyasana (fente basse), Supta Baddha Konasana — favorisent la libération des tensions accumulées dans les hanches et la poitrine, zones souvent verrouillées chez les hommes.
Plus encore, le yoga permet de redéfinir la notion de masculinité : il offre un cadre où la sensibilité n’est pas une faiblesse, mais une richesse. Dans les Upanishads, il est dit que
« le souffle est le pont entre l’extérieur et l’intérieur »
se relier à son souffle, c’est s’autoriser à habiter son corps autrement, à rencontrer son intimité sans crainte.
Longtemps associée à la performance et à la retenue émotionnelle, la masculinité contemporaine traverse une redéfinition profonde. Le yoga propose une autre forme de force : celle qui naît de l’équilibre entre effort et relâchement, puissance et vulnérabilité. En reconnectant les hommes à leur souffle, à leur corps et à leurs états intérieurs, il ouvre un espace de réconciliation avec soi, loin des injonctions de performance.
Pratique guidée : “Réconcilier force et vulnérabilité
20 à 25 minutes
Ancrage et respiration consciente, Nadi Shodhana — la respiration alternée • 3 min
Ouverture du cœur et du bassin – Anjaneyasana – fente basse • 4 min/côté
Posture restaurative et lâcher-prise — Supta Baddha Konasana • 5 min
Respiration énergisante — Ujjayi Pranayama • 5 min
Intégration silencieuse • 2 min
Une pratique qui nous traverse
Du premier élan vital de l’adolescence aux remaniements subtils de la ménopause, des transformations de la maternité aux vulnérabilités masculines, le yoga ne cesse de nous rencontrer là où nous sommes. Il ne nous demande pas de correspondre à une norme : il s’ajuste, se modèle, respire avec nous.
Ce n’est pas tant notre âge qui guide la pratique que notre état intérieur. Apprendre à l’écouter, c’est entrer dans le cœur du yoga : un art d’habiter son corps, un chemin de liberté.
La yogathérapie : quand le yoga devient soin
Si le yoga accompagne les grandes étapes de la vie, la yogathérapie explore plus loin encore : elle cherche à répondre à des besoins spécifiques, à réconcilier le corps et l’esprit dans leurs déséquilibres. Ici, la pratique devient une véritable prescription, minutieusement ajustée, au carrefour des textes fondateurs et des connaissances médicales contemporaines.
B.K.S. Iyengar fut l’un des premiers maîtres à formaliser cette approche. Dans son enseignement, il privilégiait l’usage d’accessoires — sangles, briques, bolsters — pour rendre les postures accessibles à tous les corps[^8]. Pour Iyengar, « la posture juste est celle qui permet au souffle de circuler librement ». En yogathérapie, les asanas sont choisis et modifiés afin de soulager la douleur, restaurer la mobilité et rééquilibrer les systèmes physiologiques.
Plus près de nous, Philippe Amar développe une vision complémentaire : la yogathérapie ne se limite pas au corps, elle agit sur les structures profondes de l’être. Son approche met en avant la régulation du système nerveux, la gestion des émotions et l’intégration de techniques de respiration et de méditation pour accompagner des problématiques comme le stress chronique, les troubles digestifs ou les pathologies inflammatoires[^9].
Enfin, le Dr. Lionel Coudron, médecin et fondateur de l’Institut de Yogathérapie, propose une méthodologie rigoureuse, intégrant les données scientifiques actuelles sur les liens entre yoga, neuroplasticité, inflammation et équilibre hormonal[^10]. Selon lui, le yoga agit comme un outil de régulation globale : il harmonise les systèmes physiologique, émotionnel et cognitif, offrant une ressource précieuse dans l’accompagnement des maladies chroniques et des phases de vie fragilisées.
Ainsi, la yogathérapie ne cherche pas à remplacer la médecine, mais à la compléter. Elle offre un espace où le souffle, le mouvement et l’attention deviennent des leviers thérapeutiques, renouant avec l’esprit des textes anciens qui voyaient déjà dans le yoga un art de maintenir la santé du corps et l’équilibre de l’esprit.
« Le yoga ne guérit pas la maladie. Il nous replace dans l’état où la guérison devient possible. »
— B.K.S. Iyengar
B.K.S. Iyengar fut l’un des premiers maîtres à formaliser cette approche. Dans son enseignement, il privilégiait l’usage d’accessoires — sangles, briques, bolsters — pour rendre les postures accessibles à tous les corps.
L’art de l’adaptation posturale
L’évolution de l’adaptation dans le yoga
Si l’idée d’adaptation traverse les textes anciens, elle trouve une nouvelle ampleur au XXe siècle. Krishnamacharya, figure majeure du yoga moderne, enseignait en fonction de chaque élève : âge, condition physique, constitution, état émotionnel. Il inaugurait ainsi une vision profondément individualisée.
Son fils, T.K.V. Desikachar, prolongera cette approche dans le Viniyoga, où l’adaptation devient un principe cardinal. Plus tard, Donna Farhi et Judith Hanson Lasater y ajoutent la dimension somatique : écouter non seulement les besoins visibles du corps, mais aussi ses mémoires, ses rythmes subtils, ses fluctuations intérieures.
Aujourd’hui, dans un monde pressé, cette invitation à l’écoute semble plus précieuse que jamais : un yoga qui s’ajuste à nous, qui nous accompagne, qui nous rencontre.
Le yoga au quotidien : choisir selon son souffle, son énergie, son envie
Il y a les grandes étapes de la vie, celles qui sculptent nos corps et redessinent nos paysages intérieurs. Et puis il y a le quotidien, plus intime, plus mouvant encore : ces jours où l’énergie déborde, ces matins où tout semble lourd, ces soirs où l’on cherche le silence. Le yoga, dans sa richesse, nous invite à écouter ces nuances et à laisser la pratique se modeler à l’image de notre état du moment.
Il n’y a pas un seul yoga, mais une infinité de portes d’entrée. Ce n’est pas un choix figé : c’est un dialogue vivant entre nos besoins, notre souffle et notre présence.
Quand le corps réclame du mouvement, l’élan du Vinyasa peut répondre : une pratique fluide, presque dansante, où les postures s’enchaînent au rythme de la respiration. Chaque transition devient une vague, chaque inspiration un départ, chaque expiration un retour. Idéal pour réveiller l’énergie, réchauffer les tissus, retrouver le plaisir d’habiter son corps.
À l’inverse, il y a ces jours où tout invite à ralentir. Le Yin Yoga propose alors un voyage intérieur : les postures se tiennent longtemps, le corps s’abandonne dans la gravité, les tissus profonds se dénouent. Ici, l’effort disparaît pour laisser place à l’accueil — une méditation en mouvement immobile, une rencontre avec la lenteur.
Pour celles et ceux qui souhaitent réconcilier l’écoute somatique avec le geste, Somayin offre une approche subtile : explorer les micro-mouvements, ressentir la continuité entre souffle, intention et corps, retrouver des schémas de mobilité oubliés. Dans ces instants, la pratique devient un laboratoire de perception, une plongée dans l’intelligence intrinsèque du vivant.
Le Hatha Yoga, dans sa forme la plus traditionnelle, se présente comme une voie de stabilisation. Ici, on travaille la tenue des postures, la régularité du souffle, l’attention à l’alignement : une pratique plus structurée qui invite à l’ancrage et développe la concentration. Dans une variation plus moderne, le Hatha Flow introduit un mouvement plus libre, mariant la stabilité du Hatha à la fluidité du Vinyasa.
Lorsque le mental réclame une véritable suspension, Yoga Nidra ouvre une porte vers les états de conscience profonds. Allongé, guidé par la voix, on traverse les strates de l’esprit entre veille et sommeil, comme si la pratique devenait une exploration du rêve éveillé. Le corps se régénère, l’esprit s’apaise.
Enfin, même sans pathologie particulière, le yoga thérapeutique peut se vivre comme un soutien préventif. On y privilégie les postures restauratives, les respirations équilibrantes et les séquences ciblées pour entretenir la mobilité, préserver la vitalité et cultiver une relation saine avec le corps.
Adapter sa pratique au quotidien, c’est accepter que nous ne sommes jamais les mêmes d’un jour à l’autre. C’est honorer la vérité de l’instant : certains jours appellent à la puissance, d’autres au silence ; parfois on a besoin de feu, parfois d’eau, parfois d’air. Et si le yoga nous enseigne une chose, c’est bien cela : l’écoute précède le geste.
Citation inspirante
« La pratique juste n’est pas celle que l’on suit, mais celle qui nous suit. »
— Inspiré de l’enseignement de T.K.V. Desikachar
accessoires, évolutions corporelles et écoute intérieure
Le yoga, loin de l’image figée de postures parfaites, est avant tout un art d’adaptation. Chaque corps, chaque âge, chaque journée même porte ses variations : raideurs nouvelles, fatigue accumulée, énergie changeante. Ce que nous vivons sur le tapis n’est pas une répétition mécanique, mais une écoute subtile : un dialogue entre les sensations, le souffle et la conscience.
Les textes fondateurs insistent sur cet équilibre. Patañjali, dans les Yoga Sūtra (II.46), rappelle que toute posture doit conjuguer fermeté et aisance — sthira sukham āsanam[^1]. Or, cette union de stabilité et de confort ne peut être atteinte qu’à condition de respecter la réalité du corps tel qu’il est, aujourd’hui, et non tel que nous voudrions qu’il soit. C’est là qu’interviennent les adaptations posturales et l’usage d’accessoires.
Les briques, les sangles, les bolsters, ou encore les chaises, ne sont pas des artifices destinés aux débutants : ils sont les prolongements du corps, les supports de l’exploration. B.K.S. Iyengar en a fait un véritable langage pédagogique : les accessoires deviennent des ponts entre l’intention et la possibilité, permettant à chacun·e de goûter à l’expérience posturale sans forcer ni contraindre[^2]. Une brique placée sous la main dans Trikonasana (le triangle) ne diminue pas la posture, elle l’affine. Une sangle utilisée dans Paschimottanasana (la pince) n’est pas un raccourci, mais un chemin vers une flexion plus juste.
À mesure que le corps évolue — que ce soit au fil des saisons, des étapes de vie ou simplement des cycles quotidiens — l’usage de ces supports devient un geste de bienveillance envers soi. Il nous rappelle que l’écoute des sensations prime sur la recherche de la performance. Comme le dit T.K.V. Desikachar : « Ce n’est pas la personne qui doit s’adapter au yoga, mais le yoga qui doit s’adapter à la personne »[^3].
Ainsi, utiliser un bolster pour adoucir une torsion, s’asseoir sur une chaise pour méditer, ou s’aider d’une sangle pour maintenir une ouverture d’épaules n’est pas une concession : c’est une manière de rendre la pratique vivante et durable. En acceptant de dialoguer avec le corps réel plutôt qu’avec une image idéalisée, nous entrons dans le cœur même du yoga : l’union entre le souffle, l’esprit et les sensations présentes.
Un chemin qui nous rencontre, à chaque étape
« Ce n’est pas le corps qui doit s’adapter à la posture, mais la posture qui doit s’ajuster au corps. »
— Inspiré de T.K.V. Desikachar[^1]
Pourquoi pratiquer avec des accessoires ?
Les supports ne sont pas des “béquilles”, mais des alliés pour écouter le corps et lui offrir les conditions de son plein déploiement. En acceptant l’aide des accessoires, on apprend une leçon centrale du yoga : la véritable force naît de l’écoute, et non de la lutte.
Explorer l’adaptation avec les accessoires
1. Trikonasana (le triangle) avec brique
Entrez dans la posture du triangle. Plutôt que de chercher à poser la main au sol, placez une brique sous la main avant.
•La colonne reste longue, la poitrine s’ouvre davantage
•Le regard peut s’élever vers la main supérieure sans tension dans la nuque.
=> Ici, la brique ne “remplace” pas la posture, elle en révèle l’essence : stabilité, expansion, espace respiratoire.
2. Paschimottanasana (la pince assise) avec sangle
Asseyez-vous jambes tendues, enroulez une sangle autour de la plante des pieds.
Gardez la colonne droite et le souffle fluide.
Plutôt que de forcer l’étirement, laissez la sangle vous offrir un soutien doux.
=> L’expérience n’est plus celle d’une contrainte, mais d’un allongement intériorisé, où le souffle guide le mouvement vers l’avant.
3. Savasana (le repos) avec bolster
Allongez-vous sur le dos et glissez un bolster (ou un coussin ferme) sous vos genoux
Les épaules s’ouvrent naturellement, les mâchoires se détendent.
=> Cette variation rend la posture accessible aux corps fatigués ou douloureux, et transforme Savasana en une véritable expérience de régénération.
Les lombaires se relâchent, le souffle descend plus librement dans le bassin.
Adapter sa pratique, ce n’est pas renoncer. C’est accepter que la vie nous traverse, nous transforme, et que le yoga peut devenir ce fil invisible qui relie nos âges, nos humeurs, nos métamorphoses. Peut-être est-ce là la véritable souplesse : apprendre à nous rencontrer encore et encore, avec bienveillance.
« Le yoga ne nous demande pas de changer. Il nous invite à devenir profondément nous-mêmes. »
— T.K.V. Desikachar
Références
Bhagavad-Gītā VI.17, trad. Colette Poggi, Éditions Almora, 2017.
T.K.V. Desikachar, The Heart of Yoga: Developing a Personal Practice, Inner Traditions, 1995.
Yoga Sūtra II.46, trad. Bernard Bouanchaud, Éditions Agamat, 1999.
Hatha Yoga Pradīpikā II.2-3, trad. André Van Lysebeth, Éditions Dangles, 1998.
Donna Farhi, Yoga Mind, Body & Spirit, Henry Holt & Company, 2000.
Judith Hanson Lasater, Relax and Renew: Restful Yoga for Stressful Times, Rodmell Press, 1995.
B.K.S. Iyengar, Light on Yoga, HarperCollins, 1966.
Philippe Amar, Yogathérapie : Soigner le corps, apaiser l’esprit, Éditions Jouvence, 2018.
Lionel Coudron, La Yogathérapie, Éditions Odile Jacob, 2019.




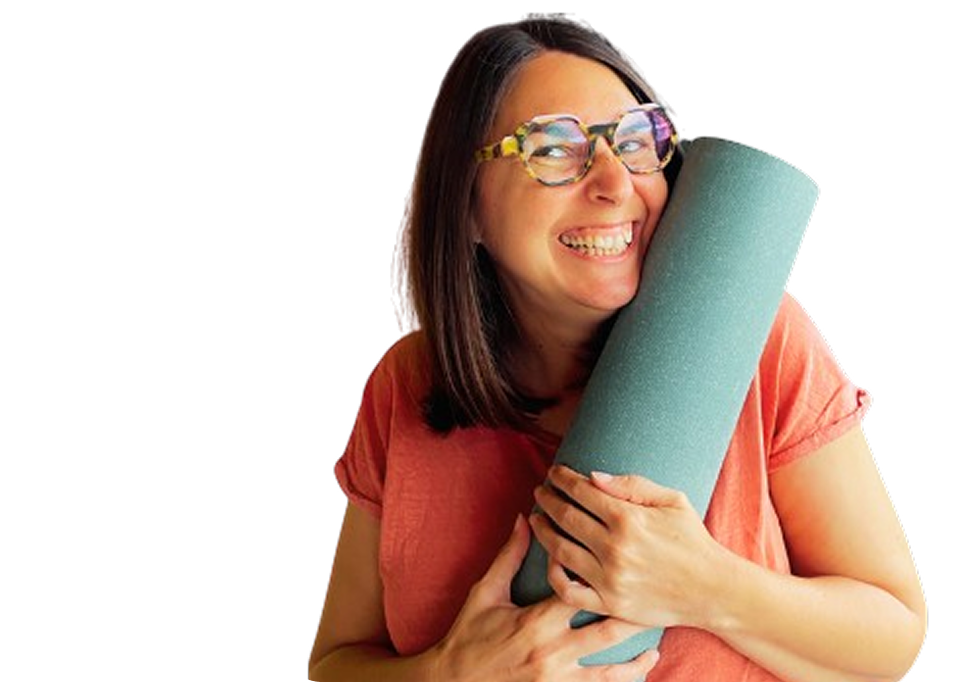
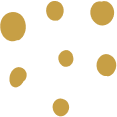

Laisser un commentaire